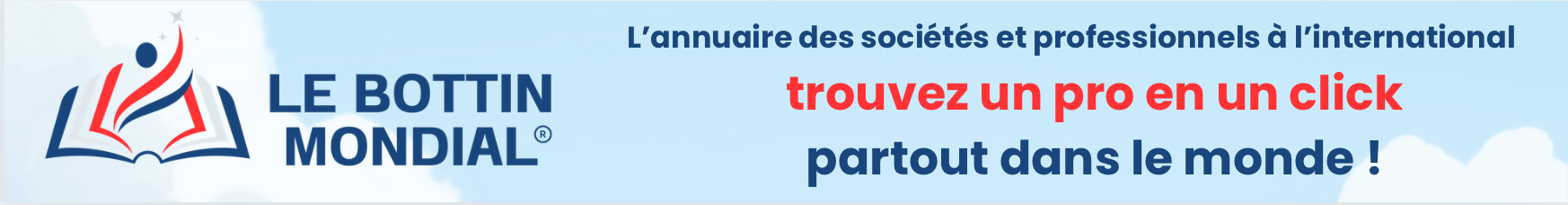Avez-vous déjà envisagé de changer de vie et de vous installer au Canada ? Sur "La radio des Français dans le monde", Gauthier Seys nous invite à explorer les défis et les préparatifs nécessaires pour une expatriation réussie au Canada. Il est rejoint par Aurélie Gualtieri et Sylvain Rossero du bureau Europe de Desjardins, groupe financier coopératif contribuant au[...]
A l'occcasion du "Café Citoyen" organisé par l'association "Français du Monde ADFE" : parlons du "(des)ordre mondial"Avec des événements internationaux qui bouleversent les normes établies, nous nous interrogeons sur les conséquences pour ceux qui vivent à l'étranger ou envisagent de s'expatrier. La sécurité, qu'elle soit physique ou juridique, est devenue une préoccupation majeure dans un monde où les règles[...]
Avez-vous déjà envisagé comment une expatriation pourrait transformer votre vie ? Dans cet épisode de La radio des Français dans le monde à ne pas louper, Gauthier Seys nous emmène à Singapour pour une conversation inspirante avec Julie Moulin. Ensemble, ils explorent les défis et les récompenses d'une vie à l'étranger, tout en découvrant comment Julie a su surmonter[...]
Avez-vous déjà envisagé d'investir dans l'immobilier dans une région qui allie accessibilité, dynamisme économique et un coût abordable ? Cet épisode de 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde, vous propose de découvrir les opportunités d'investissement immobilier dans la métropole lilloise. Gauthier Seys s'entretient avec Célestin Ecrepont, un expert du secteur, pour explorer les raisons qui font[...]
Avez-vous déjà envisagé de parier sur un match de foot sans risquer votre argent ? Sur La radio des Français dans le monde, nous invitons Solal Pytel, l'un des 3 cofondateurs de l'application Gamby qui révolutionne le monde des paris sportifs en permettant aux utilisateurs de vivre l'excitation du pari sans les risques financiers habituels. Avec plus de 200[...]
Saviez-vous que la simple photo d'identité, que nous considérons souvent comme une formalité, peut être source de grandes différences culturelles à travers le monde ? Dans cet épisode de "10 minutes, le podcast des Français dans le monde", Gauthier Seys s'entretient avec Émile Menetrey pour explorer les complexités et les subtilités qui entourent la création de photos d'identité à[...]
Bienvenue à l'IÉSEG, School of Management !Dans cet épisode de "10 minutes, le podcast des Français dans le monde", Gauthier Seys s'interroge sur l'impact de l'expérience internationale sur la vie personnelle et professionnelle. En compagnie d'Armelle Dujardin Vorilhon, directrice des études et de l'expérience étudiante à l'IESEG, ils explorent les défis et les richesses de la mobilité internationale, tant[...]
Avez-vous déjà pensé à l'impact que peut avoir un simple projet personnel sur le monde entier ? Dans cet épisode de "10 minutes, le podcast des Français dans le monde", Gauthier Seys nous invite à découvrir l'histoire inspirante d'Hervé Heyraud, fondateur de lepetitjournal.com, qui célèbre ses 25 ans d'existence. En revenant sur les débuts de cette aventure, nous explorons[...]
Avez-vous déjà envisagé de tout quitter pour vivre une nouvelle aventure au Canada ? Dans cet épisode de "10 minutes, le podcast des Français dans le Monde", Gauthier Seys explore cette question captivante avec son invité, Bastien Planchat, cofondateur de Canada Explorers. Ce podcast, qui dure 10 minutes, invite les auditeurs à réfléchir à la possibilité de commencer une[...]
Avez-vous déjà été confronté à une situation de harcèlement au travail, surtout dans un contexte d'expatriation ? Dans cet épisode du podcast 10 minutes, nous plongeons dans un sujet souvent tabou et pourtant crucial pour de nombreux expatriés : le harcèlement au travail lors d'une expatriation. Comment le reconnaître, comment y faire face et surtout, comment s'y préparer ?[...]
Avez-vous déjà envisagé de changer de vie et de partir vivre au Canada ? Cet épisode du podcast "Français dans le Monde" pourrait bien être le point de départ de votre nouvelle aventure. Gauthier Seys vous accueille pour une discussion captivante avec Claire Linder et Steve Chassé, représentants de l'ambassade du Canada à Paris. Ensemble, ils explorent les opportunités[...]
Êtes-vous prêt à transformer votre année grâce à la lecture ? Sur La radio des Français dans le monde, voici votre rendez vous "Livres" avec Lireka.com, le libraire en ligne des expatriés : Gauthier Seys, accompagné des passionnantes Emma et Clémence, vous invite à explorer des résolutions littéraires qui transcendent les frontières et enrichissent votre expérience internationale. La lecture,[...]
Avez-vous déjà rêvé de tout quitter pour vivre sur une île paradisiaque ? Dans cet épisode de "10 minutes, le podcast des Français dans le Monde", réalisé dans le cadre du partenariat avec Lepetitjournal.com, Gauthier Seys nous emmène à Bali, une île en Indonésie connue pour ses paysages volcaniques et ses décors de rêve. À travers une discussion captivante,[...]
Qu'est-ce qui pousse un sénateur à voir le monde comme un village et à s'efforcer de créer des ponts entre les cultures ? Dans ce podcast spécial de "La radio des Français dans le monde", Gauthier Seys nous emmène à Londres pour une discussion fascinante avec Olivier Cadic, un sénateur des Français établis hors de France. Olivier partage son[...]
Avez-vous déjà envisagé de vivre au Canada ou vous êtes-vous demandé ce qui rend ce pays si unique ? Gauthier Seys de "La radio des Français dans le monde" explore les mystères du Canada avec Valérie Lion, journaliste chez Bayard et autrice du livre "Comprendre les Canadiens". Ensemble, ils démystifient les idées reçues et plongent dans les diverses facettes[...]